


| Prix pour | 1 toise de pré | 1 noyer | dépréciation |
| Demandé par le propriétaire | 20.- | 500.- | 120.- |
| Offert par les constructeurs | 4.- | 25.- | 60.- |
| Taxe de la commission | 10.- | 50.- | 80.- |
| Salaire pour | Un ingénieur | Fr. 400.- | Par mois |
| « | Un terrassier | Fr. 2.50 | Par jour |
| « | Un mineur | Fr. 2.75 | Par jour |
| « | Un contremaître | Fr. 4.20 | Par jour |
| « | Un char à 1 cheval | Fr. 7.50 | Par jour |
| « | Un char à 2 chevaux | Fr. 12.- | Par jour |
| Prix payés pour | 1 kg. De pain | 28 à 32 ct. |
| « | 1 kg. De fromage | 120 à 140 ct. |
| « | 1 kg. De beurre | 140 à 170 ct. |
| « | 1 kg. De boeuf | 108 à 110 ct. |
| « | 1 kg de veau | 64 à 76 ct. |
| « | 1 bouteille de vin | 70 ct. |
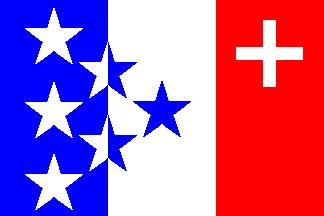 le drapeau de la Romandie.
le drapeau de la Romandie.
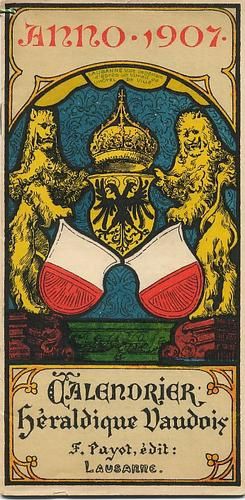
F.Payot, éditeur à Lausanne, publié par Fréd. Th. Dubois















Automobile
Martin Fischer Cette marque ne vécut que de 1909 à 1914. Elle fut fondée à Zurich par Martin Fischer, qui avait fait ses premières armes dans la conception automobile à la Turicum et qui fut considéré comme l’un des plus inventifs et des plus éclectiques de son pays. Il inventa notamment un changement de vitesse avec pignons à denture interne et un moteur avec distribution à fourreau. La 10/33 fut un modèle de succès. Elle était dotée des deux innovations en question et de roues à fixation rapide, par un seul bouton central. Moteur à l’avant, refroidissement par eau, transmission à cardan. La puissance allait jusqu’à 33 ch. à 1 200 tours ; allumage à magnéto Bosch, embrayage à disques multiples, freins à pédale agissant sur la transmission, à main sur les tambours.
Avant la guerre, Fischer avait conçu un moteur à six cylindres qui ne put être réalisé qu’à 3 exemplaires. Il reprit son activité de concepteur libre après le conflit et proposa en 1919 une petite voiture avec places en tandem et en 1921 un nouveau moteur avec distribution à fourreau qu’il céda à une firme allemande.
L’invention la plus précieuse de Fischer fut peut-être la boîte à engrenages à denture interne ; aussi en illustra-t-il un emblème posé sur le tableau des voitures qu’il fabriquait.
***************
La Pic-Pic
Le nom bizarre de cette marque vient des trois premières lettres des noms de ses fondateurs Piccard et Pictet). D'abord, elle construisit des parties de voitures. En 1904, elle fut reprise par la S.A.G. (Société d'automobiles à Genève), qui avait comme concepteur Mark Birkigt. La S.A.G. dissoute, Piccard et Pictet reprirent une complète autonomie et se mirent à produire des machines solides et efficaces. Celle de 1919, avait un moteur à fourreau, sous brevet Argyll, d'une puissance de 50 ch à 1800 tours, carburateur Zénith, allumage à magnéto Scintilla. C'était une voiture très finie, avec compteur kilométrique, montre, ampèremètre et volmètre sur le tableau de bord. le niveau d'huile était également indiqué.
La Pic-Pic fut également engagée en cpmpétition: au Grand Prix de France de 1914 participèrent deux voitures de 4 432 cc avec moteur à fourreau et freins sur les quatre roues.
La Première Guerre mondiale valut à cette usine des bons de commande dus, à la robustesse de ses véhicules, mais, en 1920, elle commença à rencontrer des difficultés à cause de la concurrence des voitures d'importation. La Pic-Pic disparut en pratique en 1924, bien qu'en 1922, soit deux ans après avoir mis fin une première fois à son activité, elle eût été reprise par un nouveau groupe financier qui permit à la maison suisse de mettre en chantier une 3 000 à quatre cylindres dont furent vendus 300 exemplaires.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le premier brevet pour un moteur à explosion, est déposé par François Isaac de Rivaz (Paris 1752 - Sion 1829) en savoir plus.... www.histomobile.com
http://www.vea.qc.ca/vea/marques/picpic.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Piccard
http://www.pictet.com/fr/home.html
Écrivain francophone de Suisse romande (Pays de Vaud) il s’exprime en 1930 dans un journal, pour contester l’érection d’une tour, aujourd’hui figure emblématique de Lausanne.
C. F. RAMUZ
Sur une ville qui a mal tourné
De temps en temps, un événement sans grande importance en lui-même, mais qui, parce qu’il est un fait et un fait précis et qu’il se prête à la discussion, vient secouer chez nous l’indifférence générale et mettre pour un peu de temps de l’animation autour des tables de café. On voit le pays sortir de l’état de torpeur où il vit d’ordinaire et qu’explique suffisamment son caractère de pays neutre, sans accès à la mer et sans colonies. Le débat grossit, s’anime, semble devoir un instant aboutir, puis meurt tout à coup de sa belle mort, et il n’en est plus question. La solution n’est même pas intervenue. Elle n’intervient que plus tard ; et généralement il n’y a pas de solution, parce qu’il n’y a qu’une demi solution. On a cherché à contenter tout le monde. Et personne n’est content, mais personne ne dit plus rien. C’est ce qui va se passer sans doute à propos de cette tour qu’un « consortium » se proposait, et se propose sans doute encore, d’élever à Lausanne, et au sujet de laquelle toute la population s’est passionnée, il n’y a pas longtemps, on se sait d’ailleurs pas trop pourquoi. Il semble bien qu’on ait assisté à un phénomène de polarisation, l’un des pôles étant le respect du passé, l’autre le souci de l’avenir ; et, passé et avenir ayant paru contradictoires, chacun s’est rallié à l’objet de son goût ; en l’espèce, d’une part, la cathédrale devenue symbole, de l’autre et non moins symbolique un « gratte-ciel ». le malheur est que cette tour, dont j’ai vu un dessin, ne m’a rien paru avoir d’un gratte-ciel, et m’a semblé représenter fort mal en l’occurrence l’architecture dite moderne. Elle m’a paru au contraire assez « vieillotte » et tout entachée de réminiscences. Elle m’a paru enfin parfaitement inutile. Car que va-t-on y loger qu’on n’ait pu loger ailleurs ? On voit que l’architecte a dû se débattre douloureusement entre la nécessité où il était d’obéir à des besoins tout commerciaux et son désir bien naturel de satisfaire à certains principes d’architecture. Ainsi les derniers étages m’ont paru être entièrement vitrés, ce qui crée un impression désagréable de transparence, à cause de l’altitude où ils s’élèvent, et étant dans le vide eux-mêmes. Cette tour semble devenir de plus en plus poreuse à mesure qu’elle s’éloigne du sol et comme s’atténuer au lieu de s’affirmer, de sorte qu’elle est sans sommet, sans terminaison, sans accent final. D’ailleurs « proprette », je n’en disconviens pas (comme tout ce qui se fait chez nous), mais c’est tout ce qu’on peut en dire. Ce qui était, d’ailleurs, surtout en cause, c’était sa hauteur. On nous donnait des chiffres. Il s’agissait, bien entendu, de sa hauteur absolue. C’est elle qui paraissait à beaucoup consternante. Est-il permis de faire remarquer que les chiffres ici ne signifient rien ? Une tour peut avoir cent mètres et paraître petite ; elle peut n’avoir que vingt mètres et paraître grande. La tour en question doit avoir, je crois bien, une quarantaine de mètres et elle m’a paru essentiellement moyenne, c’est-à-dire rien du tout : à cause des deux longues lignes horizontales d’où elle se détache (autant qu’il me souvient) vers la moitié de sa hauteur, ce qui suffit déjà à la priver de tout élan ; de sorte qu’elle ne m’a guère paru être qu’un ornement assez prétentieux à une bâtisse elle-même assez prétentieuse ; de sorte qu’on se prononcerait utilement contre la tour pour des raisons de modernisme et puis pour des raisons de dignité, si la question pouvait avoir encore ; à Lausanne, du moins, aucune importance, c’est-à-dire si la ville était vraiment pourvue encore d’un caractère ou d’une signification qu’il s’agirait de sauvegarder. Comme ce n’est pas le cas, je pense que les sages s’abstiendront, ce qu’ils ont déjà fait sans doute – et d’autant plus que tout le débat reposait, comme on vient de voir, sur le pire des malentendus.
Ù
Car chaque ville a eu un caractère au moment où sa vie avait une signification. L’architecture d’une ville n’est que la cristallisation visible d’un ensemble de sentiments et de besoins strictement subordonnés l’un à l’autre : sociaux, politiques, religieux. Nous avons sans sortir de Suisse (et l’exemple est très bien choisi, à cause des gouvernements cantonaux qui font de chacune de ses villes une petite capitale) toute une série de types, que le passé a édifiés, que le présent entame et renie un peu plus chaque jour ; si bien qu’il est très passionnant de voir agir en sens contraire ces forces et d’en évaluer le potentiel. Il y a les villes patriciennes qui sont des cités, comme Fribourg l’est encore, comme Genève l’a été ; et il y a les bourgades, centres de pays féodaux ou de territoires paysans, comme Berne et comme Lausanne. Lausanne, bâtie d’abord en terrain plat, au temps de la « paix romaine », s’est hissée sur ses collines par la suite, pour mettre plus facilement en état de défense son bien essentiel : une cathédrale, ses biens secondaires : quelques maisons nobles et quelques bureaux. Ne retenons que son exemple : et voyons qu’elle n’est guère qu’un centre religieux qui se trouvait, en même temps, comme il est naturel, être un centre d’échanges : ce qui suppose une justice, ce qui suppose des notaires, puis une vaste place de foire et autour d’elle ceux qui en vivent, on veut dire une population d’artisans et de boutiquiers, eux-mêmes restés longtemps à demi paysans. C’est cette vie villageoise subsistant à l’intérieur même d’une agglomération urbaine, qui caractérise la bourgade, outre qu’elle a, contrairement à la cité, une population essentiellement flottante à cause de l’apport périodique des pèlerinages, de l’afflux momentané des paysans arrivant à dates fixes vendre leurs produits et faire leurs achats. Je pense qu’il y a encore des Lausannois qui se souviennent d’avoir connu certains samedis une ville tout à fait encombrée, et non pas seulement certains de ses quartiers, mais même la rue de Bourg ou Saint-François, d’hommes à blouse bleue, de femmes à coiffe ou à chapeau, ou les deux, le chapeau sur la coiffe, comme moi-même j’en ai vu. Et surtout de gens qui étaient chez eux, qu’on ne voit plus ou qu’on ne voit plus guère, et qui ne sont plus chez eux nulle part, sauf sur la Riponne. Il est permis pourtant d’imaginer qu’un très petit bourg comme Lausanne a continué de mener la même existence pendant des siècles, encore que la Réforme ait dû lui porter un premier coup (par la suppression des pèlerinages). Ville isolée, comme tous les autres bourgs, mais au centre d’un pays riches et qui se suffisait à lui-même, les changements ne pouvaient lui venir que du dehors, qui étaient ceux de la civilisation, ceux des inventions qui se faisaient autour d’elle, et où elle avait peu de part, mais contre lesquelles ou pour lesquelles elle avait du moins (e a encore) à prendre parti. Il est malheureusement impossible d’esquisser ici l’historique des transformations survenues et toutes subies un peu malgré nous ; tenons-nous-en à celles qui nous ont été particulières, car il y en a et d’essentielles. Il faut voir, en effet, qu’une ville est placée plus ou moins heureusement dans un paysage (au dire des passants, car généralement les habitants n’ont là-dessus d’autres opinion que celle qui leur est suggérée), on veut dire dans un site plus ou moins beau ; - et que la nature qui ne compte pas d’abord, qui ne compte pour personne peut commencer à compter tout à coup et même à compter beaucoup pour tout le monde. Il y a ainsi des révolutions dans le goût et dans la mode ; et elles sont dues généralement à un seul homme (comme toutes les révolutions, comme tout ce qui se fait d’important, comme tout ce qui se fait de grand). Osera-t-on dire que l’événement essentiel pour notre pays, et, par conséquent, pour Lausanne, a été la naissance de Rousseau ou, si on aime mieux, l’avènement du naturisme ? La Nouvelle Héloïse paraît et un petit pays tout à fait inconnu devient subitement, pour des centaines de lecteurs, le centre du monde. Bien entendu, les conséquences économiques ne s’en sont pas fait sentir tout de suite ; bien entendu les « visiteurs » n’ont d’abord été chez nous qu’assez peu nombreux, leur importance n’étant que qualitative. Mais, comme il arrive toujours, et parce que la quantité n’est qu’une dégradation de la qualité, celle-ci a été remplacée bientôt par celle-là. Voltaire, Gibbon, beaucoup de marquis français, beaucoup de Lords venus d’Angleterre ont été supplantés, au cours du XIXe siècle, par une infinité de particuliers dépourvus de toute illustration, mais non d’argent, ce qui nous intéressait surtout, puisque c’est là l’origine du tourisme. Il faut voir aussi que pendant ce temps les chemins de fer étaient inventés, la grande industrie prenait son essor, les échanges se multipliaient, et que pour toutes ces raisons et beaucoup d’autres, chacune agissant sur le phénomène, le vieux bourg autour de sa cathédrale et de son château, tout en cherchant à perpétuer sa propre vie (ce qu’il tâche encore de faire), allait subissant mille influences, en somme pour lui favorables, on veut dire matériellement favorables, puisqu’il se développait avec une rapidité de plus en plus accélérée, et que, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va.
ê
On bâtissait. Mais encore faut-il savoir où bâtir et comment ? Je pense (entre parenthèses) qu’on a bien bâti aussi longtemps qu’on ne s’est pas posé la question de savoir comment bâtir, parce qu’on le savait d’avance. Or, à un moment donné et à cause des apports venus de l’étranger (entrepreneurs, main-d’œuvre, exemples), voici la question qui se pose. On ne bâtit plus comme on a toujours bâti. Et puis on ne sait plus où bâtir, ne serait-ce déjà que parce que le prix du terrain monte. Et, le prix du terrain montant, il faut que les maisons pour rester « rentables » deviennent plus hautes. On voit la complexité de la question ou des deux questions, car elles sont étroitement liées l’une à l’autre. Toujours est-il qu’elles ont dû se poser pour la première fois dans toute leur intensité à Lausanne vers 1860 ou 70. Et tout se gâte. Il y aurait fallut un homme et nous n’en avons pas eu. Il aurait fallu que survînt à ce moment-là dans nos administrations quelque chose de plus qu’un simple administrateur ou teneur de comptes, un simple gérant plus ou moins bien doué de la prospérité publique, ce que j’appelle un homme, c’est-à-dire un individu doué de toutes les qualités d’homme, qui ne sont pas seulement la possibilité de calculer, ni même celles de combiner plus ou moins bien ce qui existe, mais d’imaginer ce qui devrait être et de faire en sorte que ce qui devrait être soit. Supposons qu’il eût existé : son premier soin aurait dû être de faire redescendre Lausanne dans la plaine ; là était le grand principe auquel il convenait de tout subordonner. Plaine est d’ailleurs une façon de dire ; on veut parler des terrains relativement plats qui s’étendent entre la gare et le lac. Il aurait vu (l’homme en question) que Lausanne n’avait plus rien à faire sur sa colline, sur ses collines, où elle n’était montée que comme un gamin qui a peur grimpe sur un mur ; et que, si nous n’avions plus la « paix romaine », elle n’en avait pas moins été remplacée par quelque chose que je ne sais comment nommer, qui n’est certainement pas la paix et peut-être même pas la sécurité (surtout aujourd’hui), - disons un ensemble de conditions qui faisaient qu’une position élevée ne nous servait décidément plus à rien, sinon à être « pittoresques », ce qui ne suffit pas, mais aurait pu du moins être sauvegardé. Il aurait fallu voir qu’une ville se compose essentiellement de quartiers ou peut se répartir en quartiers, dont les conditions d’existence sont différentes, - et qu’en particulier les quartiers d’affaires ont besoin d’espaces vastes, bien ouverts de tout côté, largement percés de rues droites où la circulation est facile ; même si on ne pouvait prévoir alors ni les tramways, ni les automobiles, il fallait songer aux camions de toute espèce, aux voitures, aux simples piétons. L’homme dont je parle, s’il était venu, aurait donc décidé de faire émigrer les quartiers d’affaires autour et au-dessous de la gare où justement le terrain offrait beaucoup de facilités ; et de les faire suivre ou même précéder dans leur déplacement par tout ce qui a rapport avec une gare, ce qui a rapport au commerce et aux échanges, en particulier la poste et les banques. Quel débarras ! Car, considérant alors ce qui restait de la ville, telle que son passé l’avait faite, et telle qu’il souhaitait que l’avenir la fît, il aurait vu que l’industrie qui ailleurs est tout n’y était rien ou peu de chose ; que l’activité simplifiée de Lausanne était déterminée par sa double fonction de petite capitale et de ville d’étrangers ; ce qui supposait d’une part un quartier administratif ou gouvernemental, de l’autre un quartier de plaisance (on verra tout à l’heure le sens qu’il faut donner à ce mot) ; outre que sa situation particulière, et pour les deux raisons ci-dessus, comportait de nombreuses écoles, dont une académie qui allait devenir université. Il aurait décidé de loger toute l’administration cantonale à la Cité (ce qui a été fait d’ailleurs ou à peu près), mais d’y loger aussi les établissements d’instruction publique, ou dans ses alentours, selon un plan à établir ; de consacrer la Riponne et les quartiers voisins aux échanges locaux (comme c’était déjà le cas et comme c’est encore le cas) ; de restituer enfin la place Saint-François qui avait été jusqu’alors le centre des affaires (la poste, ni la Banque cantonale n’étaient encore bâties) à ce qui semblerait bien être son rôle naturel dans l’économie de la ville, par sa position privilégiée et l’emplacement de l’église, d’où l’on pouvait jouir du côté du sud de la vue la plus étendue, qui est une valeur et même une valeur d’argent. On imagine sans peine, même aujourd’hui, au midi de la place, une succession ou une superposition d’esplanades, avec jardin public, un ou deux cafés à terrasses (ce qui nous manque tellement), une salle de concerts, des bancs et des tables où à l’ombre des tentes ou de quelques beaux arbres on aurait pu l’été compter les bateaux, suivre de l’œil la tache blanche d’une barque à voiles de Montreux à Ouchy ou d’Ouchy à Thonon, contempler des kilomètres et des kilomètres d’eau bleue ou grise ou blanche ou noire ouverte de toute part à plat au-dessous de vous ; tout cela en plein cœur de la ville, ce qui est très important. Car c’est toujours au cœur d’une ville que se donnent les rendez-vous ; on le voit bien aujourd’hui encore. Il faut dire que ces rendez-vous sont singulièrement bousculés. La place manque. On n’a rien prévu. On a voulu tout réunir en un seul point, au lieu de départager et de classer les activités. Il aurait fallu ordonner, c’est-à-dire d’abord imaginer. On se serait encore préoccupé, par exemple, d’ouvrir une large artère d’accès facile du quartier de la gare, c’est-à-dire le quartier des affaires, au quartier du petit commerce et des écoles ; l’amorce en existait : c’était le tunnel du funiculaire qu’il n’y aurait eu qu’à élargir, qu’à éclairer, et qu’à rendre accessible aux piétons, ce qui n’eût pas été impossible ; ainsi on aurait sauvegardé en les isolant l’une de l’autre la ville du passé, mais qui pouvait servir encore, et cette ville de l’avenir, comme on l’appelle, qui aurait eu alors toute la place qu’il lui fallait. Elles auraient été réunies et en quelque sorte surmontées par une ville de plaisir : j’entends le plaisir qui est pour tout le monde et gratuit, étant fait d’air, de soleil et d’espace ; le plaisir d’être ensemble, le plaisir de pouvoir causer tranquillement entre amis. Au lieu de quoi, eh bien, on voit ce qui est arrivé, et ce que ça en a coûté, je veux dire de regrets et de sommes d’argent. Combien de millions pour l’espèce de palais « florentin » qui devait loger l’université, qui ne la loge même pas, étant aux trois quarts inhabitable, et qu’on a été enterrer, c’est bien le mot, dans un flanc d’une colline qui était jolie et joliment surmontée de murs anciens, mais c’est probablement pourquoi on a jugé bon de la défigurer à jamais. Combien de millions pour dresser un écran opaque et définitif entre les passants et la vue au sud de l’église Saint-François, elle-même transformée en une espèce de pièce montée posée sur un plat de confiseur entre les bâtisses massives qui l’enserrent de partout, elle qui était faite pour être vue de loin ! Et on ne la voit pas, et à vrai dire on ne voit rien, même pas les autos qui arrivent en tout sens et jouent à cache-cache, tournant en rond autour de cet énorme écueil. On ne voit surtout ni le lac, ni les montagnes, ni le ciel, du lieu même qui était ainsi disposé beaucoup mieux que Montbenon pour qu’ils fussent vus tout entiers. Il semble que tout ait été calculé à rebours, - au rebours du bon sens et au rebours de la nature.
Or, si l’exemple de l’ordre impose l’ordre, l’exemple du désordre conseille le désordre. Il n’a eu qu’à partir du centre où il trouvait tous les encouragements et à gagner de là vers la périphérie. Le désordre et tous les désordres, pas seulement le désordre architectural et esthétique, qui n’est d’ailleurs que le signe du désordre intérieur ; mais le désordre dans les habitudes et les goûts, et le désordre dans les comptes : ainsi on a pu voir à diverses reprises tel bâtiment être démoli, puis rebâti à la même place, et presque de la même façon et dans les mêmes dimensions, mais les loyers avaient quadruplé ; - parce qu’il y avait quelque part la « poste centrale » ; il a été impossible d’empêcher les banques de venir s’installer précisément tout à côté, c’est-à-dire justement où elles auraient dû ne pas être ; - on a bâti de hautes maisons à sept étages où il en fallait qui n’en eussent qu’un et des maisons à un étage où elles auraient pu en avoir plusieurs sans inconvénient aucun ; - et je n’insiste pas sur le spectacle d’une banlieue hétéroclite qui s’est répandue peu à peu dans tout le pays, des Alpes au Jura ; qui n’est pas seulement laide, mais morne (car il y a des laideurs vivantes), morne et morte, morne et proprette, et parfaitement satisfaite d’elle-même au milieu de la pire incohérence qui soit.
ê
C’est qu’un homme a manqué. Il n’a pas été là quand il aurait dû être là. On bien s’il a été là (ce qui est possible), il a été sans influence. Il semble bien que notre système démocratique ne puisse produire, ou du moins porter au pouvoir, que des hommes « moyens », étant le régime de la moyenne ; et l’homme moyen ne peut résoudre que les problèmes moyens ; et en outre l’homme moyen n’est jamais seul à décider. Il n’est qu’une unité, quels que soient par ailleurs son grade et sa fonction, au sein de la collectivité seule responsable, mais qui ne l’est déjà plus en ce qu’elle est une collectivité. Il appartient à un parti ; il est de la majorité ou de la minorité : son raisonnement et ses vues sont ceux de ses co-partenaires. Il ne domine pas, donc il est dominé. Il peut être très honnête et l’est généralement, bon administrateur, on le répète, de ce qui est, mais nullement artisan du futur. Alors, le futur se fait tout seul, c’est-à-dire se fait mal ; c’est-à-dire à coups de votations contradictoires et incohérentes, à grands renforts de compromis, avec infiniment de vues particulières et de détail, point de vue d’ensemble. Ce qui est frappant, me semble-t-il, dans l’aventure de cette tour, car il faut bien y revenir, c’est la mesquinerie des raisons qu’on a fait valoir « pour ou contre ». Ici encore personne n’a voulu voir le cas général ; il est vrai qu’il était trop tard. On ne voit pas qu’une ville est une personne vivante qui « tourne bien » ou « tourne mal », qui peut d’ailleurs avoir « bien tourné » une première fois et puis tourner mal par la suite. Je n’ai cité la tour que pour mémoire, parce qu’elle n’est qu’un détail, mais le détail est seul de nature à soulever, chez nous, les passions. Les soulever pour un moment, et puis elles retombent et s’endorment. Que cette tour se fasse ou ne se fasse pas est une question qui est depuis longtemps indifférente. Née du désordre, elle ajoutera au désordre, sans y apporter aucun embellissement, ni d’ailleurs aucun enlaidissement sans doute, ce qui serait difficile. Le plus probable est qu’on ne la remarquera même pas, si elle se fait et que, si elle ne se fait pas, elle sera remplacée par quelque chose d’équivalent, sinon de pire. Traitée en tant que détail et indépendamment d’un plan d’ensemble qui n’existe pas, et ne saurait plus exister, la question est sans solution. Consolons-nous. L’architecture est l’expression de la société elle-même, de ce qu’elle croit, de ce qu’elle pense, de ce qu’elle sent. Le cas ne nous est pas particulier. Toutes les villes « tournent mal » plus ou moins vite, plus ou moins mal en ce moment ; c’est que la société elle-même tourne mal. Quand une société ne croit à rien, ne pense à rien, ne sent rien, elle ne peut plus avoir d’architecture à elle. Elle vit d’emprunts. Elle copie autour d’elle des modèles tout faits, qu’elle va chercher très loin, aux Inde, en Norvège. Pourquoi pas ? Chacun ne se détermine que selon ses goûts, dont on voit ce qu’ils valent, ou bien le désir de paraître, dont on devine assez les aboutissements. Toutes les villes ont mal tourné ou tournent mal en ce moment ; j’entends celles qui ont un passé, bien entendu. Nous sommes dans ce qu’on appelle, par euphémisme, une période de transition. Il faut attendre qu’elle soit finie. Il faut attendre que la société ait trouvé de nouveau une raison de vivre, car elle n’en a plus. Elle ne vit que d’habitudes, et l’habitude ne suffit pas pour inventer. L’habitude, une fois ses aises sauvegardées, car tout est là pour elle, laisse faire, sans plus. Il faut que la société ait d’abord réappris à vivre. Alors elle aura de nouveau une architecture.

Article publié dans Aujourd’hui (Lausanne)
le 18 décembre 1930
Article tiré du livre : LAUSANNE Une ville qui a mal tourné édité par H. L. Mermod à Lausanne 1946 à 2000 exemplaires
http://pages.infinit.net/poibru/ramuz/