8 décembre 2007
6
08
/12
/décembre
/2007
17:32
Ce jour-ci il n’y avait pas d’interrogatoire. J’épluchais donc le journal, passant des souffrances indicibles et des maladies aux divorces de la clique princière internationale, je lus le roman-photo à l’eau de rose et le « Nebelspalter » réactionnaire. La colère était ainsi à nouveau attisée : cette littérature merdique qui appartient au processus d’abrutissement renforçait en moi l’esprit de résistance, d’autant plus que j’ai conscience d’appartenir aux privilégiés qui ont déjà fui depuis longtemps cette machine d’abrutissement du peuple. Seulement maintenant je le comprends concrètement. Tu ne peux que penser à tous les prisonniers qui devraient s’édifier à partir de ces lectures ; même s’il s’agit de voleurs ou de criminels dans le sens traditionnel, ils ne pourraient tirer qu’une conclusion à partir de ces lectures : nous volerons mieux la prochaine fois car c’est la marque de voiture XY qui est à la mode.
Et là tu renonces définitivement à faire une déposition quand on te la demande, car tu perçois clairement : il n’y a rien de commun entre toi et cet appareil d’Etat, avec ses flics et tout ce système ; tout compromis, tout fléchissement n’est qu’une trahison de ta propre conscience, de la cause commune. Et dès cet instant je commençai à dominer en quelque sorte la situation.
Mais ça m’avait pris toute une semaine ! Il m’apparaissait avec évidence que je devais aller aux interrogatoires non plus passivement mais activement, que je devais penser à une stratégie – pour laquelle en priorité rien ne devait affaiblir ma capacité de résistance retrouvée, que je devais compter totalement sur moi-même, et pourtant que je devais donner l’impression d’être intéressée à une discussion – car c’était, c’est du moins ce que j’imaginais, la seule possibilité pour le moment d’apprendre quelque chose sur les autres. Ainsi donner l’apparence de l’hésitation en ce qui concerne le refus de déposer, pour ainsi rester dans la course, mais ne pas déposer. Cette stratégie me paraissait pour l’instant la seule acceptable, car je savais que même si j’obtenais un avocat, je n’aurais jamais pu m’entretenir seule avec lui.
Je ne pourrais pas prétendre ne plus avoir eu dès cet instant de dépression, de maux de tête, de moments de désespoir, avoir trouvé la journée en cellule moins désagréable, ou trouver que le temps passait plus vite. Non, la situation extérieure restait la même mais je ne la subissais plus totalement, je parvenais à avoir une certaine suite dans les idées, une certaine logique. Je me regardais un peu d’en haut ; je me représentais comme un être qui devait maintenant prouver si tout cela n’était qu’une blague ou un engagement politique sérieux, et par la même occasion je voulais aussi tester si j’étais vraiment une « femme ». C’est dans cet état d’esprit que je me trouvais lorsqu’au matin du…
Jeudi 27 mars 1975
… on vint me chercher pour m’interroger. Je vis les flics sous un autre jour. Leurs tentatives les rendaient désespérés : mais déposez donc s’il vous plait, c’est pour votre bien, puisque vos amis ont tout reconnu, où étiez-vous le 1er mars (ah, ah, vous ne le savez pas, mais nous, nous le savons), où étiez-vous le 12 mars (ah bon, vous ne le savez pas, mais nous, nous étions avec vous à Lugano), ah vous ne connaissez pas ces adresses, vous ne voulez rien en dire ? Ah, ha, nous on les connaît les gens. Oui, depuis six mois ils vous ont hébergée ici, et vous étiez tout d’abord ici et puis là… etc.
Ayant obtenu beaucoup d’informations mais sans avoir avoué quelque chose (et sur le ton de la conversation je m’étais renseignée sur le Vietnam et le Portugal – et on m’avait même répondu !) j’ai regagné ma cellule.
Mais vraisemblablement les flics avaient tout à coup compris que je ne jouais pas leur jeu, car le même jour je fus « invitée » à un « entretien » sans protocole par un flic de la police fédérale. J’étais déjà couchée quand on vint me chercher et on m’emmena directement dans une « salle d’interrogatoire ». On m’enferma d’abord dans la pièce, j’ai eu le temps d’étudier et d’admirer les « œuvres » des détenus. Puis une homme entra : jeune, gentil, dynamique – et je pensai que c’était l’avocat. Mon œil ! Le monsieur se présenta en qualité de policier fédéral. Tiens, je pensais un flic de la RFA. Mais non un de la police fédérale suisse. Il disait être venu sans mauvaises intentions. Pas de protocole, pas d’interrogatoires, rien qu’un entretien pour faire connaissance, pour discuter avec moi, apprendre quelque chose de ma vie. Comme nous étions du même âge, on aurait par conséquent pas mal de choses en commun. Mon instinct me disait de me tenir sur mes gardes : je pensais aux portugais, eux, ils étaient interrogés alternativement par de « méchants » et de « gentils » flics, dans les cas où les détenus ne disaient rien du tout ! Prends garde, alors !
Au début, ce type montrait aussi cet intérêt humain que tous les hommes d’affaires portent à leur partenaire d’affaires avant de signer un contrat avantageux. Ces gens, je les connaissais depuis des années : tout est bien étudié, c’est-à-dire, seul le succès compte. C’est pourquoi les hommes d’affaires couchent même avec les femmes les plus « moches » de leur chef.
Mais je n’étais pas encore tout à fait convaincue des intentions de ce monsieur. Tout de même, on a bien causé une bonne heure ensemble – j’ai accepté la première cigarette – et je la fumai avec plaisir, quoique nerveusement.
Il est très, très facile de tomber dans ce piège après avoir été traité de la façon la plus infâme pendant une longue semaine et que tout pue la taule et le désespoir. Et puis il y a quand même un homme cultivé en face de toi qui te parle de la victoire du vietcong, du régime fasciste au Chili et en Espagne, de la pauvreté dans le midi italien. Une telle situation est très dangereuse, et on peut tomber dans le panneau. Là, il est facile de se laisser prendre, on peut avoir envie de vider son sac, auprès d’un type du même âge, « intelligent » et compréhensif à la fois. Un type comme celui-ci travaille sur la base du tâtonnement mutuel afin de frapper dur et sans pitié au bon moment.
à suivre...



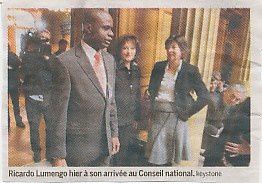



 Denis de Rougemont
Denis de Rougemont